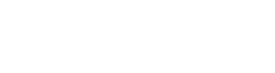« Toulouse-Lautrec, ou la vitesse à la Belle Époque – un intermède entre Turner et Marinetti »
(Anmerkung: Die Bildverweise beziehen sich auf den Ausstellungskatalog «Toulouse-Lautrec und die Photographie»)
Interrogez-vous un historien d’art sur la vitesse ? il en appelle immédiatement à Marinetti, lequel a effectivement commencé d’exalter « le démon de la vitesse » dès 1904 (Destruction. Poèmes lyriques, Librairie Léon Vanier éditeur – Albert Messein succ.). Interrogez-vous un littérateur ? de vous citer illico e presto Octave Mirbeau, pour son roman, La 628-E8 (Bibliothèque Charpentier / Eugène Fasquelle éditeur, 1907), excepté que, on oublie souvent de le notifier, loin de l’exalter, « l’automobilisme » (pour ne pas dire « l’automaboulisme », cher à Méliès) relève pour lui de la maladie mentale. Et il aura fallu une docte et patiente thèse, Le Vertige de la vitesse, de Christophe Studeny (thèse soutenue à l’E.H.E.S.S. sous la direction d’Emmanuel Le Roy Ladurie en décembre 1990), pour montrer qu’avant le fameux E=mc2 d’Einstein, Marinetti et la Grande Guerre, la vitesse, voire l’accélération de l’Histoire, devenue par suite une obsession, était loin encore d’être inscrite dans les mentalités.

Bild: Henri de Toulouse-Lautrec, Der Jockey, 1899. Farblithographie in Pinsel, Kreide und Spritztechnik, 51,6 x 36,4 cm, Sammlung E.W.K., Bern (Auschnitt)
Alors, Toulouse-Lautrec, un fou ou non de la vitesse ? L’Album de famille réuni par sa cousine Marie Tapié de Celeyran, passionnée de photographie, nous montre comment, au tournant de l’avant-siècle, une famille, c’est vrai plutôt aisée, enracinée dans le sud-ouest de la France, a converti sa passion héréditaire pour les chevaux en intérêt non moins passionné pour tous les moyens modernes de locomotion, du « cheval de fer », et à vapeur, devenu plus qu’adulte, aux toutes premières voitures auto-mobiles. Gageons que s’il n’avait connu un double handicap à l’âge de 14 et 15 ans, Henri n’aurait pas manqué de se mesurer à son oncle Amédée ou à son cousin Gabriel pour battre quelque record. Il dut en conséquence se contenter toujours de se faire accompagner, et faire sien le précepte en usage dans le « midi moins cinq », sa région natale, « petite vitesse et grande lenteur ». C’est ainsi qu’on le verra plus souvent faire la sieste [i] ou goûter du plaisir de la planche [ii], pour ne jouir de l’ivresse de la vitesse que par délégation (cf. par exemple L’Automobiliste, 1898 [iii]). Ce qui ne veut pas dire pour autant qu’on ne trouve pas trace d’une réelle recherche dans son œuvre.
À commencer par La Vache enragée, – lithographie livrée à la revue montmartroise éponyme, pour sa couverture, à l’occasion de la Vachalcade de mars 1896 – [iv], qui nous donne d’assister à une course poursuite effrénée, – en diagonale, et grossissant vers le bas, pour en augmenter l’effet –, où l’on voit un sergent de ville poursuivre une vache rouge de rage sous l’œil amusé de Pierrot en tandem avec Pierrette (clin d’œil à Willette), prête à encorner le fameux père La Pudeur (le sénateur René Bérenger), criant manifestement à « Sauve qui peut ! » (ill. non numérotée). On pourra rapprocher de celle-ci, pour sa même construction en diagonale, cette fois inversée, Le Fardeau de la Liberté, lithographie réalisée pour illustrer la comédie du même nom de Tristan Bernard, et qui servira de couverture à son édition en volume par les Éditions de la Revue blanche en mars 1898 [v] : où l’on voit un brave bourgeois lâcher un « Mort aux vaches ! » (sourd, mais effectivement tiré de la pièce) à l’adresse de deux pandores au point de fuite…
Avec La chaîne Simpson, affiche réalisée pour son représentant en France L[ouis] B[ouglé, dit] Spoke [vi], la vitesse est mieux que suggérée, puisque nous voici au vélodrome Buffalo de Neuilly, établissement dirigé par le même Tristan Bernard, où il nous est donné d’assister à une séance d’entraînement derrière quintuplette (et non un tandem, comme l’a trouvé écrit). Ont même pu être identifiés, sur son bicycle, Constant Huret (1870-1951), plusieurs fois vainqueur du « Bol d’or », – course d’endurance de 24 heures créée en 1894 par le journal Paris-Pédale et qui se déroulait alors sur ce même stade –, et en cinquième position sur la quintuplette, une femme, Hélène Dutrieu (1877-1961), dite « la flèche humaine » [vii], qui aurait remporté à 18 ans, en 1895, le record de l’heure sur piste.
Force nous est ici de renvoyer à deux « illustrations » de ces épreuves de force. La première vient d’un record réalisé aux U.S.A., où une sextuplette – sextuplette à 6 pédaliers des frères Stearns, basés à Syracuse / NY – parvint à battre sur 1,5 miles, soit, 2,4 km, un train du Western Railway : article et photo parus dans le Daily Herald (Delphos / Ohio) du 29 juillet 1896, retransmis par la Revue encyclopédique de la Librairie Larousse (n° 156, 29 août 1896) [viii]. Et bien sûr, deuxième illustration, on ne peut pas ne pas penser à la fameuse « Course des Dix-Mille Milles » imaginée par Alfred Jarry dans son roman, Le Surmâle (paru aux Éditions de la Revue blanche en mai 1902), telle que, même si très postérieurement, rendue par Chaval avec La Course (dessin au stylo à bille noir, 1964) [ix].
Retour au calme pourrait-on dire ensuite, avec Partie de campagne , lithographie réalisée pour le deuxième Album d’estampes originales de la Galerie Ambroise Vollard paru en 1897, et Attelage en tandem, réalisée à la même date [x], illustrant identiquement une promenade amoureuse en calèche [un « tonneau de Marty » pour les connaisseurs] au rythme d’un chien trottinant.
Rude contrapposition en revanche, cet Automobiliste de 1898 (cf. ill. n° 3), en l’occurrence Gabriel Tapié de Celeyran, pour une séance de drague à deux vitesses oserait-on dire ici : une machine fumante [une de Dion], lancée à contre-courant d’une belle indifférente, châtelaine des lieux promenant nonchalamment son chien.
Fort mystérieux pour nous cet ultime Chien et le perroquet, daté de février 1899 [xi], qu’on dit être un rêve ou un cauchemar lors qu’il vient d’être interné, mettant en tout cas en scène des temporalités, et donc vitesses très différentes, voire une suspension totale du temps. Qu’attend le chien, langue pendante, du perroquet chapeauté, haut perché, fumant au clair de lune, cependant qu’un cirque s’installe et qu’un train traverse le paysage ? Nous dirons seulement que, parodiant manifestement le fameux proverbe arabo-turc (« Les chiens aboient, la caravane passe »), ici « le chemin de fer passe, mais le chien n’aboie pas ».
Dernier rappel de la prime passion héritée de son père : Le Jockey, de la série des Courses, mai 1899 [xii], dépeignant une séance d’entraînement d’un jockey derrière son entraîneur, avec toute la fougue qu’on lui devine.
Tout a donc commencé, pour l’histoire de l’art, non proprement avec le « chemin de fer » (première ligne autorisée, 1823) – les wagons étant encore, sur le modèle des malles-postes, tirés par des chevaux –, mais avec l’apparition comme moyen de traction de la locomotive à vapeur. Une invention anglaise, dont on attribue essentiellement la paternité à l’ingénieur George Stephenson (1781-1848), – et, rappelons-le, destinée originellement au transport du charbon avant de s’adapter à celui des voyageurs –, vite acclimatée en France grâce aux recherches d’un ingénieur originaire d’Annonay, Marc Seguin (1786-1875) – brevet déposé le 13 décembre 1827 –, et dont la mise en circulation devait se généraliser à la fin des années 1830.
Mais la diligence n’avait pas dit son dernier mot, la course était même engagée, comme en témoigne cette lithographie anonyme, issue de l’imagerie populaire, illustrant une course entre un chemin de fer et une voiture à vapeur (de fait, un tricycle) [xiii]. D’elle, on pourra rapprocher une reconstitution à fin pédagogique, certes beaucoup plus tardive, mais avec un réel souci de fidélité à l’époque, illustration signée Joseph et Louis Beuzon, destinée au Premier Livre d’ Histoire de France (« cours Gauthier et Deschamps, révisé par Aubin Aymard », Hachette, 1933 [xiv]) et représentant une course – datée « entre la Monarchie de Juillet 1830 et la Révolution de 1848 » – entre un chemin de fer de voyageurs et une diligence, clairement identifiée, de la « Compagnie Lafitte des Messageries royales Paris-Rouen ».
Le noble art ne pouvait rester en retrait, et – messieurs les Anglais tirèrent les premiers… –, c’est à William Turner (1775-1851) que l’on doit la première et plus majestueuse illustration des débuts du règne industriel, avec son tableau Rain, Steam and Speed (huile sur toile, 91×121,8 cm, 1844, Londres, National Gallery) [xv]. Un train passant dans le brouillard et la fumée de la locomotive emmêlés, sur le pont de chemin de fer enjambant la Tamise, où l’on devine en contre-point, encore calmement voguer un grand voilier et une frèle embarcation de marchandises. Hors l’original traitement du sujet, et qui en a fait sa renommée, c’est qu’il ne s’agit pas non plus de n’importe quel pont, ni de n’importe quel train : du pont construit en 1837-39 par l’un des plus éminents ingénieurs de l’époque, british mais d’origine française par son père, Isambard Kingdom Brunel (1806-1859), financé par la Great Western Railway, et destiné à assurer la ligne Londres-Bristol ; et d’une locomotive, la plus moderne alors, la Firefly Class, qui, en 1843, avait battu le record de vitesse avec une pointe à 150 km/h.
La France devra attendre Claude Monet (1840-1926), et sa revisitation de la nature, du paysage, faisant notamment suite à sa reconstruction aux lendemains de la « culotte » de 1870. Un premier tableau réalisé en 1872, Le Convoi de chemin de fer (huile sur toile, 48×76 cm, Kanagawa/Japon, Pola Museum of Art) [xvi], apparemment uniquement de marchandises, où la fumée de la locomotive contrecarre la fumée des cheminées d’usines environnantes, sous l’œil de dames au parasol contemplant le nouveau « spectacle ». Le plus célèbre est réalisé l’année suivante, Le Pont du chemin de fer à Argenteuil (huile sur toile, 60×98,4 cm, 1877, premiers détenteurs : Jean-Baptiste Faure, puis le prince de Wagram, etc., dernièrement vendu chez Christie’s, à New York, 6 mai 2008, pour un prix record de 41 480 000 $…) [xvii]. Monet y « salue » le nouveau pont construit par les Établissements métallurgiques Joly (constructeurs également des halles Baltard, de la Tour Eiffel), en remplacement du pont classique (sept arches, avec cintres en bois, s’appuyant sur des piles en pierre) construit en 1867 et détruit peu après par la guerre de 1870. De paisibles promeneurs contemplent un enfumage, fumée et nuages confondus, pendant que de modestes voiliers profitent du soleil. Toujours la vitesse par contrapposition.
On pourrait ici, dans notre recensement, lui faire suivre Le Pont de l’Europe, gare Saint-Lazare, un des 12 tableaux réalisés autour de la gare parisienne récemment rénovée (huile sur toile, 64 x 81 cm, 1877, Musée Marmottan). Sauf que Monet y a placé un feu rouge, commandant l’arrêt de toute manœuvre et de tout mouvement. Ne sauraient pas davantage, et pour la même raison, être pris en compte les tableaux que cet étonnant carrefour dit de l’Europe a inspirés en 1887 et 1888 à Norbert Goenette (1854-1894) : qu’il s’agisse du Pont de l’Europe pris la nuit, puis en hiver et en été, un petit panneau d’interdiction orange vient suspendre le temps et tout mouvement.
En revanche, Louis Anquetin (1861-1932) a su, s’est employé, lui, avec son homologue Pont de l’Europe (pastel, 68×51 cm, 1889 – coll. part.) [xviii], à y rétablir toute une dynamique. Ce carrefour-viaduc en forme de X à 6 branches, venu remplacer l’ancien tunnel, avec ses entretoises elles-mêmes en forme de X, prouesse de l’ingénieur des Ponts et Chaussées, également directeur de la Compagnie des chemins de fer de l’Ouest, Adolphe Jullien (1803-1873), réalisée entre 1865 et 1867, vient nettement séparer, opposer deux mondes, telle la Caverne de Platon mais inversée. Au soleil, le monde « routier » de piétons – marionnettes, chevaux et fiacres aux trajectoires aléatoires ; dans le sombre goufre, le monde ferroviaire, des locomotives crachant leur vapeur, manœuvrant avant et arrière, soit, en situation d’arrivée ou de départ, et selon des trajectoires rectilignes. Ce monde que décrira cette même année Émile Zola, au début de la Bête humaine (roman paru d’abord en feuilleton dans La Vie populaire).
Aux extrêmes de la possibilité de représentation de la vitesse sur deux dimensions en cette fin de siècle, nous ne saurions ici achever le parcours sans évoquer deux dernières toiles, réalisées, consciemment ou non, avec un humour qui nous fait rejoindre les premiers produits de l’imagerie populaire. La première, un Vendredi saint en Castille (huile sur toile, 81×65,5 cm, 1904, Musée des Beaux-Arts de Bilbao) [xix], signée du peintre espagnol Dario de Regoyos (1857-1913), adepte de Monet, et qui s’est très attaché à peindre l’irruption du train à vapeur dans les, jusque là, paisibles campagnes. Ici, une confrontation extrême entre une pédestre procession religieuse et le (profane) passage d’un train en survol. La seconde, certes, beaucoup plus tardive : La durée poignardée (huile sur toile, 147×98,7 cm, 1938, Chicago, Art Institute) [xx] signée René Magritte (1898-1967), un « accident » surréaliste, mais qui n’est pas sans rappeler un accident, lui bien réel, d’un train, survenu à Paris, en gare Montparnasse, le 22 octobre 1895 [xxi]. Au « Que fait ce train sorti de la gare ? » (carte postale alors largement diffusée) répond « Que fait ce train sorti de la plus bourgeoise des cheminées ? ». La vitesse, concluent les humoristes, ce sont prioritairement, sa contre-partie, les accidents.
Mais que faisait pendant tout ce temps, à l’épreuve du réel, la photographie ? Peut-être faut-il ici commencer par rappeler, ce que l’on néglige souvent de faire, les simples lois physiologiques de l’accommodation. Dit prosaïquement, l’œil humain, d’un voyageur depuis la fenêtre du train, perçoit, au premier plan, un flou, des « raies » (comme l’avait relevé Victor Hugo dès 1837) ; au plan moyen, un paysage en mouvement, distinct, identifiable, sur lequel se concentre l’essentiel du champ du regard ; à l’arrière-plan, comme à l’horizon de la mer, sinon la fixité, un à peine perceptible, très, infiniment lent mouvement. La vitesse n’est donc ainsi perçue que par la superposition, la mise en parallèle, et décalage, de ces trois registres.
Les premiers voyageurs, écrivains-voyageurs, ont par ailleurs tôt noté – tel un Paul de Kock en 1842 – que le chemin de fer était à lui seul une « véritable lanterne magique de la nature ». On parlera aussi de kaléidoscope naturel, pour les images uniquement successives et difficilement recomposables qui s’offrent du paysage vu du train – c’est le constat, pour le déplorer, que fera précisément un Jongkind, lequel, on le sait, avec son œil venu de Hollande, ne fut pas pour rien dans le renouvellement de la peinture de paysage. Images, faudrait-il encore ici ajouter, qui peuvent ainsi passer de la plus fidèle, réaliste figuration à la plus pure abstraction.
Bref, toute la question était de matérialiser cette perception, et de créer la nouvelle « camera oscura » adéquate.
Il faudra attendre le début des annés 1880, précisément, un brevet accordé le 19 avril 1882 à un photographe belge, Ernest Candèze (1827-1898), pour un « appareil permettant de prendre des vues instantanées », et, conséquemment, pour voir apparaître les premières photographies réalisées depuis un train en marche. La pratique va alors faire fureur ; on va même voir organisés des concours – défis, défis à la vitesse, où se multiplieront prises de chevaux au galop, de vagues déferlantes en bord de mer, d’acrobates voltigeurs dans les hauteurs des cirques…
Mais la « descente du train », si l’on peut dire, fut rude : c’est que ces images, au départ donc prises d’un train, ne se révèlaient pas autres que si on les avait prises en restant sans bouger au bord de la voie. Le fameux paradoxe de Zénon (d’Élée), lequel avait largement démontré qu’à décomposer le temps en instants, une flèche ne pouvait jamais atteindre son but. Bref, le mouvement qu’on espérait saisir, avait totalement disparu.
Il y eut bien aussi la chronophotographie, une série d’expérimentations rétrospectivement aujourd’hui bien connues, initiées à partir de 1878 par le photographe-chercheur anglais Edward Muybridge (1830-1904), relayées à partir de 1882 par son exact contemporain, le physiologiste chercheur bourguignon Étienne-Jules Marey (1830-1904). Le défi à l’origine, rappelons-le, expliquer le galop du cheval, et résultat : c’est toute la peinture classique qui s’écroulait, pour non-respect de la position réelle des pattes du dit animal (Meissonnier fut le premier à corriger). Seulement, que l’on eut recours à plusieurs objectifs (Muybridge), ou à un « fusil » puis à un obturateur rotatif (Marey), on n’obtenait du galop d’un cheval, de la marche de l’homme (ou de la femme), du vol des oiseaux, qu’une succession d’images fixes, qui nécessitaient le passage par un projecteur pour recomposer le mouvement, a fortiori la vitesse.
Que restait-il dès lors à la photographie ? Il ne lui restait plus, coincée comme la peinture par Euclide, par les deux dimensions, qu’à pratiquer le flou – et difficile alors, pour une technique qui commençait à vouloir prétendre au titre d’Art, de faire passer ces/ses images qui avaient tout d’images « ratées » (et on était loin par ailleurs de pouvoir encore reconnaître la valeur du non finito). Deuxième issue, la séquence panoramique, réalisée par juxtaposition d’images. Le flou, c’est, on l’a vu, ce qu’avait largement pratiqué la peinture, avec sa surabondance de fumées de trains ; le panorama, c’est aussi ce qu’on avait depuis aussi longtemps pratiqué, notamment dans les pays anglo-saxons, pour parer la carence du tableau de chevalet, avec les Moving Panorama – dont le plus célèbre reste le Trans-Siberian Railway Panorama, « monté » à l’occasion de l’Exposition Universelle de 1900 [xxii].
Restait encore, directement inspirée de la photographie, l’affiche, et l’affiche publicitaire, destinée à célébrer les grandes victoires… de la vitesse. Nous retiendrons tout particulièrement ici celles signées d’Émile Sevelinge (1871-1936), avec son « Circuit des Ardennes 1903 » [xxiii], en hommage à son vainqueur, sur une Panhard, le baron Pierre de Crawhez (1874-1925), et son « Circuit d’Auvergne 1905 », en hommage à son vainqueur, sur une Richard-Brasier [xxiv], Léon Théry (1879-1909), qui se passent de tout commentaire.
Nous avons gardé pour conclure deux expériences photographiques originales, réalisées à un siècle de distance, et qui n’ont rien à envier à la peinture. La première, celle de Robert Demachy (1859-1936), chef de file du « pictorialisme » – courant qui entendait ne pas être un simple enregistrement – copie du réel, mais une retranscription, et « Inutile de nous écraser sous les noms de Rembrandt, de Van Dyck, de Rousseau ou de Millet. Nos visées sont plus modestes », écrivait-il. De lui, une photo clairement intitulée « Speed » [xxv], tirée sur papier préparé à la gomme bichromatée, parue dans Camera Work, la revue d’Alfred Stieglitz, en 1904. La seconde est celle de Gérard Dufresne (né en 1938), qui a travaillé notamment pour l’ « Observatoire photographique du paysage », – département créé en octobre 1991, rattaché alors au ministère de l’Environnement, et dédié à sa sauvegarde –, avec un « inidentifiable » Paysage [xxvi], pris du TGV Paris-Grenoble, exposé en 2005 (exposition personnelle, « Du train où vont les choses… », Atelier Lab, 21, rue de Tanger, 75019 Paris), à vous donner le tournis…
Notes / Illustrations
(Die Bildverweise beziehen sich auf den Ausstellungskatalog «Toulouse-Lautrec und die Photographie»)
[i]. Henri fait la sieste (au Bosc ? à Celeyran ?), photo [cat. p. 173]
[ii]. Henri fait la planche (dans le bassin d’Arcachon ?), , photo Maurice Guibert [cat. p. 203]
[iii]. L’Automobiliste, litho en noir, 37,5×26,8cm, 1898 [cat. p. 193] : À contre-courant ou drague à deux vitesses : Gabriel Tapié de Celeyran, à bord de sa machine fumante [une de Dion], à l’indifférence de la châtelaine comme de son chien.
[iv]. La Vache enragée, litho coul. 79×57,5 cm, 1896, dédiée à l’ami Simonet [cat. p. 62] – couv. La Vache enragée n° 1, mars 1896 : Pour honorer la « Vachalcade » de Montmartre : course poursuite entre un flic à pied, Pierrot en tandem avec Pierrette [hommage à Willette], une vache enragée, un chien lâché et le sénateur René Bérenger, dit le père La Pudeur (1830-1915), criant à “sauve-qui-peut !”.
[v]. Le Fardeau de la Liberté, litho coul. 16,3×16,7 cm, tirée en 49,8×32,6 cm, 1898 [cat. p. 62] – couv. de la comédie de Tristan Bernard, en vol., Éditions de La Revue blanche, n° 10, mars 1898 (prééditée dans La Revue blanche, n° 96, 1er juin 1897, p. 649-665). [Autre] Construction en diagonale : homme de dos un bras levé, au 1er plan ; un chien – plan moyen ; au loin – au point de fuite -, deux pandores. On devine le cri (tiré de la pièce) : « Mort aux vaches ! »
[vi]. La chaîne Simpson, litho coul. – affiche 82×120 cm, 1896, signée d’un éléphant miniature, Impr. Chaix [cat. p. 189] : Constant Huret (1870-1951), le champion à l’entraînement, au vélodrome Buffalo dirigé par Tristan Bernard. en bicycle derrière une quintuplette, avec, en 5ème position, une femme [sans doute Hélène Dutrieu (1877-1961), dite « la flèche humaine »]
[vii]. Affiche publicitaire (non signée) : La Chaîne Simpson, L.B. Spoke [cat. p. 63]. « Mlle Hélène Dutrieu, “la flèche humaine”, recordwoman de vitesse de l’heure sur piste, fin 1895, au vélodrome Buffalo.
[viii]. « Stearns Sextuplet », Daily Herald (Delphos, Ohio), 29 juill. 1896 [cat p. 63] – répercuté par La Revue encyclopédique, Librairie Larousse, n° 156, 29 août 1896 : la sextuplette à 6 pédaliers des frères Stearns (Benjamin & Andrews, Syracuse/NY) bat un train du Western Railway sur 1,5 miles (2,4 km).
[ix]. Chaval, La Course [du Surmâle], stylo à bille noir, 16×24 cm, 1964, coll. part. [non reprise]. À destination d’une éventuelle réédition du Surmâle d’Alfred Jarry, illustrant la fameuse « Course [herculéenne] des Dix-mille Milles ».
[x]. Partie de campagne, litho coul. 40×52 cm, 1897 [cat. p. 60], 2ème Album d’estampes originales, Galerie Ambroise Vollard. Variante : Attelage en tandem, litho en noir, 26,4×41,2 cm [non reprise]. Promenade amoureuse en calèche [un tonneau de Marty], suivie par un chien trottinant« Qui va piano va sano » ; traduction dans le sud-ouest de la France : « Petite vitesse et grande lenteur »
[xi]. Le chien et le perroquet, litho en noir 30,8×26,2 cm, datée 8 fév. 1899, dédiée à Henri Stern et signée d’un éléphant miniature [cat. p. 64]. De nouveau, temporalités différentes – avec détournement d’un vieux proverbe arabo-turc : Le chemin de fer passe, mais ici le chien n’aboie pas…
[xii]. Le Jockey, litho coul. 51,8×36,2 cm, de la série des Courses, datée 17 mai 1899 [cat. p. 182]. Séance d’entraînement, faite de mémoire, pour prouver au médecin, comme avec la série du Cirque, qu’il n’avait rien perdu de ses moyens.
[xiii]. Anonyme, litho coul., fin années 1830 [non reprise]. Illustre une course entre un des premiers chemins de fer et une voiture à vapeur.
[xiv]. Joseph & Louis Beuzon, « Les premiers chemins de fer », ill. rétrospective pour le Premier Livre d’ Histoire de France, cours Gauthier et Deschamps, révisé par Aubin Aymard, Hachette, 1933 [non reprise]. Illustre une course entre une diligence de la Compagnie Lafitte des Messageries royales Paris-Rouen et le chemin de fer, entre Monarchie de Juillet et Révolution de 1848.
[xv]. William Turner (Londres, 1775 – Chelsea, 1851), Rain, Steam and Speed – The Great Western Railway, huile sur toile, 91×121,8 cm, 1844 – Londres, National Gallery [non reprise].
[xvi]. Claude Monet (1840-1926), Convoi de chemin de fer, huile sur toile, 48×76 cm, 1872 – Kanagawa/ Japon, Pola Museum of Art [non reprise].
[xvii]. Claude Monet, Pont du chemin de fer à Argenteuil, huile sur toile, 60×98,4 cm, 1874 – vente Christie’s, New York, 2008, nouveau propriétaire inconnu [cat. p. 64].
[xviii]. Louis Anquetin (1861-1932), Le Pont de l’Europe, pastel, 68×51 cm, 1889 – coll. part. [cat. p. 65]
[xix]. Dario de Regoyos (Ribadesella, 1857 – Barcelone, 1913),, Vendredi saint en Castille, huile sur toile, 81×65,5 cm, 1904, Bilbao, Museo de Bellas Artes de Bilbao [non reprise]. Le profane et le sacré : une traditionnelle procession religieuse, tandis que passe le « monstre de fer ». Le monstre aboie, la procession passe…
[xx]. René Magritte (Lessines/Belg., 1898 – Schaerneek, 1967),, La durée poignardée, huile sur toile, 147×98,7 cm, 1938, Chicago, Art Institute [cat. p. 66]. Apparition hirsute d’une locomotive dans une cheminée bourgeoise.
[xxi] Carte postale, Accident de chemin de fer en gare Montparnasse, Paris (survenu le 22 octobre 1895) [cat. p. 66].
[xxii]. « The Trans-Siberian Railway Panorama », Exposition Universelle Paris 1900 (Saint-Pétersbourg, Musée de l’Ermitage – restauré en 2004) [non reprise]. Voir aussi Salle des Fresques, Gare de Lyon-Paris (partie ancienne, avant 1920) [non reprise
[xxiii]. Émile Sevelinge (1871-1936), « Circuit des Ardennes [22 juin] 1903 », litho. coul. 34×55,5 cm [non reprise]. Le baron Pierre de Crawhez (Gosselies/Belg., 1874- Bruxelles, 1925), vainqueur, à bord de sa Panhard 70.
[xxiv]. Émile Sevelinge, « Circuit d’Auvergne – coupe Gordon Bennett [5 juillet] 1905 » [non reprise]. Léon Théry (Paris, 1879 – id., 1909), en course sur sa Richard-Brasier n°1, et vainqueur.
[xxv]. Robert Demachy (1859-1936), Speed/Vitesse, photo « pictorialiste », Camera Work, VII, 1904. [non reprise]. Voir aussi Eugène Verneau ( ?- 1906), Publicité « Automobiles Richard-Brasier », 1904 [non reprise] – Théry déjà vainqueur, sur sa n° 5.
[xxvi]. Gérard Dufresne (né en 1938), « Paysage » – photo prise du TGV Paris Grenoble, Exposition « Du train où vont les choses… », Paris XIX, Atelier Lab, 21, rue de Tanger, avril 2005 [non reprise] « Je fotografie en vitesse lente : 15ème / 30ème de seconde, tout en “balayant la scène” d’un geste très rapide dans le sens de la marche, censé “accompagner” avec l’appareil ce paysage qui se dérobe… ».
Bibliographie
- Paul Gayot, « L’Odyssée et l’Histoire », Subsidia pataphysica, n° 19, 2 Pédale 100/25 février 1973, p. 19-47. (Commentaire de la « Course des Dix-Mille Milles » du Surmâle, d’Alfred Jarry, Éditions de la Revue blanche, mai 1902)
- Claude Pichois, Littérature et progrès. Vitesse et vision du monde, Neuchâtel, Éditions de la Baconnière, 1973.
- Toulouse-Lautrec. Album de famille, texte : Charles de Rodat ; icono. : Jean Cazelles, présentation d’Antoine Terrasse, Paris, Hatier, 1985 (Album de photographies collectionnées par Marie Tapié de Celeyran (1881-1971), cousine de Henri, et dont elle était pour la plus grande part elle-même l’auteur, transmis à son petit-fils Charles de Rodat)
- Robert Bied (dir.), L’Aventure de la vitesse, de la monarchie de Juillet à l’entre-deux-guerres, dossier pédagogique, Paris, CRDP-Musée d’Orsay, 1986. 77 p., 12 diapo – préf. Madeleine Rébérioux.
- Christophe Studeny, Le Vertige de la vitesse : L’accélération de la France (1830-1940), thèse sous la direction de Emmanuel Le Roy Ladurie, Paris, E.H.E.S.S., déc. 1990 ; éditée sous le titre L’Invention de la vitesse – France XVIIIè-XXè siècle, Paris, NRF/Éditions Gallimard, coll. « Bibliothèque des Histoires », 1995.
- Sehnsucht, Das Panorama als Massenunterhaltung des 19. Jahrhunderts, éd Marie-Louise von Plessen et Ulrich Giersch, à l’occasion de l’exposition de Bonn, 29 mai – 10 oct. 1993, Bâle, Francfort-sur-Main, Stroemfeld Verlag/Roter Stern, 1993.
- Clément Chéroux, « Vues du train. Vision et mobilité au XIXe siècle », Études photographiques, n° 1, nov. 1996, p. 73-88.
- André Gunthert, La Conquête de l’instantané. Archéologie de l’imaginaire photographique en France, 1841-1895, thèse de doctorat, EHESS (dir. : Louis Marin, puis Hubert Damisch), février 1999. En ligne
- Claude Frontisi, « Mouvement, vitesse, dynamisme. L’espace-temps futuriste », Images Re-vues, hors série 1, « Traditions et temporalités des images », 2008 – en ligne : http://imagesrevues.revues.org/1081
- L’Europe en automobile. Octave Mirbeau écrivain voyageur, Éléonore Reverzy et Guy Ducrey (éd.), Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2009 [autour de son roman, La 628-E8, Paris, Eugène Fasquelle, 1907].
- Alain Boillat, « La figuration du mouvement dans les dessins de presse et albums illustrés signés “O’Galop” : des images en séries (culturelles) », 1895/AFRHC, n° 59, 2009, p. 22-45
- Caroline Chik, L’image paradoxale : fixité et mouvement, thèse sous la dir. de Jean-Louis Boissier, Paris VIII, 2009, Villeneuve d’Asq, Presses universitaires du Septentrion, 2011
- Philip McCouat, « Toulouse-Lautrec, the bicycle and the women’s movement », Journal of Art in Society, 2014 – en ligne : www.artinsociety.com
Veröffentlicht unter Allgemein, Gastbeitrag
Schlagwörter: Belle Époque, Jean-Paul Morel, Toulouse-Lautrec